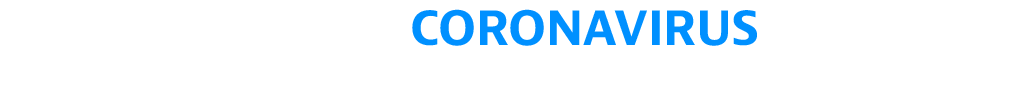Le besoin de trouver d’urgence des solutions au problème du COVID-19 a amené beaucoup de gouvernements à lancer des initiatives au pied levé et selon des procédures accélérées (appels à projets de recherche, par exemple). Une absence de coordination appropriée entre les ministères et organismes concernés risque toutefois de susciter des efforts redondants ou de passer à côté de possibilités intéressantes, ce qui peut ralentir la progression et être un facteur d’inefficience économique.
Dans les infrastructures de crise mises en place à l’échelle de l’ensemble de l’administration pour faire face à la pandémie, les modalités et le degré d’engagement des responsables de la politique de la recherche et de l’innovation varient selon les pays. Au-delà de la formulation d’avis scientifiques, il est essentiel d’assurer l’adhésion et la mobilisation de la communauté STI.
Les gouvernements peuvent apprendre les uns des autres comment améliorer la coordination stratégique des différents organes responsables en matière de recherche et d’innovation liées au COVID-19. Par exemple, certains ont déjà regroupé des activités moyennant un décloisonnement de la politique STI, que ce soit par des plans à l’échelle de l’ensemble de l’administration, des appels communs à projets de recherche et d’innovation, des programmes intégrés ou des portails en ligne conjoints.
Les solutions collectives qui débouchent sur un « guichet unique » centralisant les informations sur les possibilités de financement peuvent contribuer à garantir des conditions propices à la recherche en collaboration et au partage des données et résultats de recherche préliminaires ainsi qu’à la réalisation de tous leurs avantages.
Au-delà des réponses immédiates des pouvoirs publics au COVID-19, il existe aujourd’hui un certain nombre de politiques de la recherche et de l’innovation ‘axées sur des missions’ qui pourraient aider à faire face aux pandémies futures à l’échelle nationale ou internationale.
Le fait d’unir les efforts et de partager les informations au niveau national facilite et appuie également les initiatives de coopération internationale. En outre, la collaboration avec les plateformes et initiatives internationales de coopération en matière de recherche, comme celles soutenues par le Global Research Council et la Commission européenne, peut être bénéfique pour la coordination des réponses de la politique STI au niveau national.
La coordination des politiques STI au niveau national est primordiale, a fortiori en période de pandémie mondiale
Partout dans le monde, les gouvernements cherchent comment répondre rapidement et efficacement à la crise du COVID-19 et coordonner avec efficacité les nombreuses initiatives de recherche et d’innovation qui voient le jour dans différents domaines d’action. Compte tenu de l’urgence sanitaire, ils soutiennent logiquement en priorité la recherche et l’innovation tournées vers les diagnostics, les traitements, les vaccins et l’atténuation des effets (y compris sociaux et économiques). Une meilleure coordination de l’action publique peut rendre ces initiatives plus efficaces.
Les bienfaits de la coordination de l’action publique sont bien connus et largement admis. Les mécanismes de coordination à l’échelle de l’ensemble de l’administration – entre les différents niveaux d’administration et à l’intérieur de chacun d’eux – sont essentiels pour répondre aux divergences entre les priorités et politiques de divers secteurs. Ils favorisent des démarches cohérentes et synergiques entre les secteurs et les institutions en concentrant les ressources sur des objectifs communs. Et pourtant, la coordination et la cohérence des politiques représentent depuis fort longtemps l’un des principaux défis de l’action publique, lequel est aujourd’hui rendu plus complexe encore par les problèmes systémiques pluridimensionnels comme le changement climatique, le vieillissement des sociétés et la pandémie.
En l’occurrence, deux facteurs rendent cette coordination particulièrement difficile dans le contexte de la crise du COVID-19 :
L’incertitude. En dépit de la profusion d’informations et d’avis scientifiques, il n’existe toujours pas de consensus sur les voies de propagation du virus ni sur la façon de le traiter, sans même parler d’un éventuel vaccin. Les décideurs doivent donc trancher sur la base d’éléments d’appréciation changeants et parfois contradictoires.
L’urgence. Dans une situation où il est urgent d’agir, comme celle créée par le COVID-19, les décideurs ont dans tous les secteurs tendance à prendre des mesures sans consultations ni échanges d’informations suffisants. De nombreux acteurs de la recherche et de l’innovation ont recentré certaines activités déjà financées sur le COVID-19, mais sans vraiment pouvoir se fonder sur des orientations données par les responsables de l’action publique.
Or, une meilleure coordination de l’action au sein des administrations peut améliorer les réponses au COVID-19 en limitant les doubles emplois, en assurant que les efforts sont menés à l’échelle voulue, en permettant que les solutions potentielles soient étudiées plus largement et de façon plus durable, et en rendant plus visibles les initiatives qui proposent des financements liés au COVID-19. De fait, dans le contexte de la crise actuelle, les pouvoirs publics peuvent attendre les avantages suivants d’une coordination plus anticipative et volontaire des politiques STI :
Moins de doubles emplois dans les initiatives face au COVID-19. Le besoin de trouver d’urgence des solutions au problème du COVID-19 a amené beaucoup de gouvernements à lancer des initiatives au pied levé et selon des procédures accélérées (appels à projets de recherche, par exemple). En l’absence de coordination appropriée entre les ministères et organismes concernés, on risque toutefois de susciter ainsi des efforts redondants ou de passer à côté de possibilités intéressantes, ce qui peut ralentir la progression et être un facteur d’inefficience économique.
Étude plus large et plus durable de solutions potentielles au COVID-19. Dans un contexte de forte incertitude autour des effets potentiels d’un grand nombre d’agents pathogènes et des traitements, vaccins et diagnostics possibles, les efforts scientifiques et technologiques peuvent converger de manière trop précipitée vers un petit nombre de solutions qui donnent des résultats encourageants dans les premières phases (et deviennent ainsi prématurément le « modèle dominant »), au détriment d’autres solutions qui auraient pu se révéler plus efficaces.
Transparence et visibilité accrues des possibilités de financement disponibles pour les initiatives ciblant le COVID-19. Les nombreuses initiatives lancées par différentes institutions pour lutter contre la pandémie de COVID-19 rendent les possibilités de financement difficilement lisibles pour les exécutants de la recherche et de l’innovation. Des efforts de coordination pour centraliser les informations sur ces possibilités permettent une répartition plus rationnelle des ressources entre les projets, les équipes de recherche et les bailleurs de fonds.
Cohérence du soutien sur l’ensemble des composantes du système STI. S’il est une source de solutions potentielles à la crise du COVID-19, le système STI est aussi profondément affecté par les perturbations économiques causées par le virus. Une coordination globale permet de mieux cerner l’ensemble des conséquences de la crise du COVID-19 pour toutes les composantes de ce système et, partant, d’y répondre par des mesures plus efficaces et mieux adaptées.
Meilleures possibilités de coopération et d’exploitation des résultats. Beaucoup d’initiatives de recherche et d’innovation lancées et financées peu après le début de la pandémie dans le cadre de procédures simplifiées donneront des résultats dans les deux à six prochains mois. Si la coordination nationale et internationale entre ces nombreuses initiatives de lutte contre le COVID-19 menées par différentes institutions n’est pas à la hauteur, on peut craindre une régression notable de la coopération et des échanges de données et de résultats entre les projets financés, une interopérabilité limitée et un recul de la qualité des données et de leur interprétation.
Répartition plus rationnelle des ressources budgétaires entre les priorités en matière de STI. Aujourd’hui, des pressions très fortes sont exercées par les responsables politiques et la collectivité afin que tous les efforts soient faits pour combattre le virus, d’où le risque que les décisions prises au sommet entraînent une trop forte concentration des budgets de STI sur le COVID-19, au détriment des investissements programmés dans d’autres domaines (y compris la lutte contre d’autres maladies).
Comme l’ont montré de nombreux Examens de l’OCDE des politiques d’innovation, il existe plusieurs façons de coordonner les politiques STI : cela va de la coordination stratégique partant de tout en haut, des services du Premier ministre, par exemple (comme au Japon), à la coordination au niveau des agences (comme en Norvège). Il n’existe pas une approche optimale en la matière, et la coordination des activités ciblant le COVID-19 doit être adaptée au dispositif institutionnel particulier de chaque pays. Cette synthèse évoque un certain nombre de mesures prises par différents pays pour mieux coordonner nationalement les politiques STI au service de la lutte contre le COVID-19 ; elle n’aborde pas les efforts internationaux menés dans cette optique.
Mesures prises au niveau national pour coordonner les réponses de la politique STI au COVID-19
Coordination de la politique STI avec l’action publique dans d’autres domaines
Si beaucoup de pays ont à juste titre laissé aux autorités de santé le soin de piloter au départ la réponse au COVID-19, différents mécanismes transsectoriels ont été mis en place pour coordonner les mesures avec d’autres ministères. En fonction de la stratégie de chaque pays et de sa situation sanitaire actuelle, les organes en question sont chargés de différentes activités destinées à contenir le virus, à freiner sa propagation ou à atténuer ses effets. La communauté des chercheurs et des innovants appuie le processus décisionnel à l’œuvre dans ces structures en formulant les indispensables avis scientifiques.
À la suite des précédentes pandémies, l’Organisation mondiale de la santé requiert de la part de ses États membres qu’ils se dotent d’une structure de gouvernance et d’un plan pour faire face aux pandémies ; les membres de l’Union européenne sont soumis à une obligation similaire. L’application d’une approche à l’échelle pangouvernementale, mettant en jeu des mécanismes de coordination plurisectorielle et multipartite, occupe une place centrale dans les orientations et les documents élaborés pour aider les pays à établir leurs plans de préparation et d’intervention.
De nombreux pays recourent également à des initiatives et des structures de gouvernance spécifiques pour coordonner les activités à l’intérieur du système STI à proprement parler, en particulier pour réduire le cloisonnement entre les autorités qui supervisent les politiques en matière de recherche, d’innovation et de santé. Ces efforts n’ont pas tous la même portée ni les mêmes priorités : cela va des groupes de travail et réseaux collaboratifs aux appels à projets de recherche et d’innovation conjoints en passant par des programmes intégrés. Voici quelques-unes des initiatives prises :
En Irlande, le Plan national d’action adopte une approche interministérielle pour lutter contre le COVID-19. Il institue un cadre d’action dans lequel un domaine transversal spécial porte sur la capacité de la communauté scientifique d’étayer les décisions immédiates. Dans ce contexte, le pays a mis en place un programme de recherche spécialisé avec des centres employant du personnel expérimenté pour faire la synthèse des données factuelles, pris des mesures de soutien financées par la Commission européenne en faveur des chercheurs irlandais et invité les organismes de financement à collaborer à un appel à projets de recherche dans l’optique d’interventions rapides.
En Afrique du Sud, une sous-commission interministérielle de la recherche a été créée sous l’égide du Conseil national de commandement, afin de coordonner un cadre national pour la recherche sur le COVID-19. Elle est chargée de mobiliser des financements auprès des différents organismes, de revoir les priorités des stratégies de recherche et de créer un cadre éthique et réglementaire propice à la recherche sur le virus.
Le Brésil a créé le Réseau Virus du MCTIC, qui regroupe des représentants de plusieurs ministères et organismes de financement. Ce réseau a pour but d’apporter son concours aux ministères pour l’intégration des efforts de recherche et d’innovation axés sur le COVID-19, de définir les priorités correspondantes en matière de recherche et de développer des technologies pour aider le Brésil à faire face aux nouveaux virus.
Au Canada, dans la province de Québec, les Fonds de recherche du Québec (FRQ), le ministère de l’Économie et de l’Innovation et le ministère de la Santé et des Services sociaux ont formé un groupe de travail pour coordonner leurs réponses au COVID-19. En outre, les FRQ ont créé le Réseau québécois COVID, qui réunit les institutions engagées dans la recherche sur le COVID-19 et vise à prioriser les actions et à accélérer les découvertes, notamment par la promotion de collaborations interdisciplinaires.
Coordination des initiatives de recherche relatives au COVID-19
Lorsque plusieurs organismes ou conseils de recherche mutualisent leurs ressources en vue de solliciter et de choisir des propositions, ils ont fréquemment recours à des appels à projets conjoints. Bien souvent, les partenaires appliquent des procédures simplifiées et accélérées. En règle générale, ces initiatives conjointes portent sur des travaux de recherche de courte durée, censés donner des résultats en trois à douze mois, et interviennent à un stade avancé du processus d’innovation ; par exemple, pour soutenir la mise au point et la production rapide de technologies et services de dépistage et de traitement. Cette forme de collaboration permet d’assurer une plus grande cohérence en matière de financement et de dotation, d’éviter les doubles emplois et les lacunes et de monter en échelle et en envergure.
Voici quelques exemples nationaux de coordination de la mise en œuvre des politiques dans le contexte de la crise du COVID-19 :
En Autriche, le ministère du Numérique et de l’Économie et le ministère de la Protection du climat, de l’Environnement, de la Mobilité, de l’Innovation et de la Technologie ont lancé conjointement un appel à projets pour soutenir la recherche appliquée sur les tests, les vaccins et les médicaments relatifs au COVID-19.
En Irlande, Science Foundation Ireland, Enterprise Ireland et IDA Ireland ont lancé ensemble un programme de financement de la recherche et de l’innovation pour une réponse rapide au COVID-19, qui vise à soutenir la mise au point de solutions novatrices pouvant avoir à brève échéance un effet tangible sur la crise du COVID-19 que connaît le pays. Cet appel conjoint est ouvert à tous les acteurs publics et privés, indépendamment de leur discipline et du type de projet. À l’issue d’un processus de sélection commun, les bailleurs de fonds décident conjointement quelles institutions financent quels projets. Cet appel est en outre coordonné avec un autre appel conjoint lancé par le Conseil de recherche sur la santé et le Conseil irlandais de la recherche.
En Israël, l’Autorité de l’innovation, le ministère de la Santé et l’Initiative Digital Israel, qui dépend du ministère de l’Égalité sociale, ont lancé conjointement des appels à projets auprès des entreprises technologiques du pays, qui portent sur la mise au point, l’essai et la mise en œuvre de systèmes, produits ou solutions technologiques pour lutter contre la pandémie de COVID-19.
En Italie, le gouvernement a lancé le programme Innover pour l’Italie, qui est géré par trois ministères et l’agence nationale pour le développement économique (Invitalia). Au moyen d’une plateforme commune regroupant des « appels à agir », entreprises, universités et instituts de recherche sont invités à contribuer au développement et à la production de dispositifs de prévention, de diagnostic et de surveillance du COVID-19. Le programme permet à l’État de mettre ses compétences et son pouvoir en matière de marchés publics au service de la sélection et de l’acquisition d’équipements, de technologies et d’outils innovants utiles.
Aux États-Unis, le partenariat public-privé ACTIV (Accelerating COVID-19 Therapeutic Interventions and Vaccines) vise à élaborer une stratégie de recherche coordonnée pour privilégier et accélérer le développement des traitements et vaccins les plus prometteurs. Cette initiative est pilotée par les Instituts nationaux de la santé (NIH) et réunit d’autres agences nationales compétentes, l’Agence européenne des médicaments, des organisations philanthropiques et des entreprises biopharmaceutiques. Ses travaux sont coordonnés par des organes de gouvernance spécialisés (comité exécutif et groupes de travail chargés d’aspects particuliers de la coordination).
À plus long terme, des stratégies plus globales seront nécessaires pour lutter efficacement contre le COVID-19 et prévenir d’autres pandémies. De plus en plus de pays expérimentent des « politiques d’innovation axées sur des missions » (PIAM), y compris dans le domaine de la santé. Cette démarche consiste à appliquer un ensemble coordonné de mesures de politique de la recherche et de l’innovation et de mesures réglementaires, dans le but d’atteindre des objectifs particuliers dans un laps de temps donné. Les mesures en question couvrent différents stades du cycle de l’innovation, associent des instruments destinés à favoriser à la fois l’innovation poussée par l’offre et l’innovation tirée par la demande, et s’étendent à toute une série de domaines d’action1. C’est le cas au Japon, par exemple, où le nouveau programme Moonshot R&D vise la réalisation de six objectifs ambitieux, longs et onéreux à atteindre (« moonshot »), parmi lesquels le développement de capacités de prévision des maladies et d’intervention ultra-précoces d’ici à 2050. En Australie, l’initiative Genomics Health Future’s Mission (GHFM) vise à sauver ou transformer la vie de plus de 200 000 citoyens à l’horizon 2030 par des tests, des diagnostics et des traitements fondés sur la génomique. Dotée de 500 millions AUD sur dix ans, la GHFM coordonne les activités de différentes autorités sectorielles, fédérales et territoriales, ainsi que d’autres entités publiques et privées de soins de santé. Elle a donné lieu au financement d’études sur la génomique des pathogènes et, plus récemment, sur le COVID-19.
Alors que la plupart des PIAM ont un caractère purement national, c’est à l’échelle internationale que leur efficacité face au COVID-19 serait maximale.
Coordination des efforts pour faire connaître les possibilités de financement
En complément de ces initiatives, les gouvernements ont investi pour rendre plus visibles les différentes possibilités de financement. Cela passe notamment par des inventaires et des cartographies des projets STI pertinents, ainsi que par différents portails et plateformes en ligne centralisant les informations utiles sur les activités STI liées au COVID-19. L’amélioration de la collecte et de la diffusion de ces informations facilite la coordination formelle et informelle, contribuant ainsi à éviter les doubles emplois, et stimule aussi potentiellement la coopération entre chercheurs. Voici quelques exemples de ce type d’initiatives :
La Commission européenne a lancé la plateforme corona de l’espace européen de recherche (EER), qui est un guichet unique d’information sur le financement de la recherche et de l’innovation liées au coronavirus (appels, projets financés, etc.). Cette plateforme comprend également un espace consacré aux activités nationales.
En France, le consortium REACTing est un réseau collaboratif multidisciplinaire regroupant des instituts de recherche français, qui vise à la fois à préparer la recherche pour faire face aux crises épidémiques futures et à la coordonner durant les épidémies. Entre autres activités, il suit et encourage le partage de données, il promeut les bonnes pratiques et la standardisation en matière de collecte de données et il coordonne et rassemble les acteurs de la recherche française sur le COVID-19.
En Italie, le ministère des Universités et de la Recherche a lancé une activité de cartographie pour recueillir des informations sur l’ensemble des projets concernant le COVID-19 en cours dans les universités et établissements publics de recherche, dans le but de limiter leur éclatement et d’éviter les doubles emplois.
Au Luxembourg, le Fonds national de la recherche (FNR) a conclu un partenariat avec les principaux établissements de recherche pour créer une plateforme COVID-19 nationale. Les chercheurs peuvent y soumettre leurs idées de projets, parcourir et examiner les propositions et les projets en cours, et prendre connaissance des dernières études publiées sur le COVID-19.
Au Portugal, la Fondation pour la science et la technologie et l’Agence pour la recherche clinique et l’innovation biomédicale ont créé le portail « Science 4 Covid-19 », en partenariat avec les autorités sanitaires et des établissements publics et privés de recherche scientifique. Ce portail centralise les informations sur les idées, publications, possibilités de financement et autres mesures en cours, ainsi que sur les capacités de recherche pertinentes.
Pour aller plus loin
OCDE (2020), « OECD Survey on Science and Innovation Policy Responses to Coronavirus (Covid19) », page web, OCDE, Paris, https://stip.oecd.org/Covid.html.
OCDE (2020), Community platform of the OECD project on mission-oriented innovation policies to address societal challenges, OCDE, Paris, https://community.oecd.org/community/cstp/mission-oriented-policies.
OCDE (2018), Scientific Advice during Crises: Facilitating Transnational Co-operation and Exchange of Information, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264304413-en.
Note
Voir le projet de l’OCDE sur la conception et la mise en œuvre de politiques d’innovation axées sur des missions.