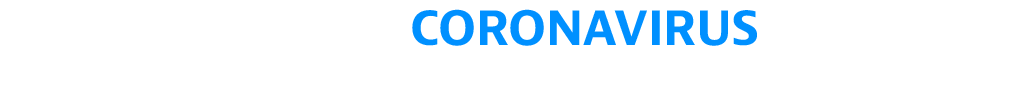Mis à jour le 4 juin 2020
Abstract
La pêche et l’aquaculture fournissent des aliments nutritifs à des centaines de millions de personnes dans le monde et des moyens de subsistance à plus de 10 % de la population mondiale. Tous les aspects des chaînes d’approvisionnement en produits halieutiques et aquacoles sont fortement affectés par la pandémie de COVID-19, avec des emplois, des revenus et la sécurité alimentaire menacés. Les gouvernements et l’industrie doivent réagir pour faire face aux difficultés économiques et sociales immédiates que la crise provoque dans le secteur de la pêche. Mais, les gouvernements doivent également maintenir des ambitions fortes, à long terme, pour la protection des ressources naturelles et des écosystèmes, et la viabilité des pêcheries.
En matière de politiques publiques pour la pêche, les considérations relatives à l’économie, à l’équité et à l’environnement orientent toutes vers des recommendations similaires : soutenir les revenus de ceux qui en ont le plus besoin plutôt que subventionner les intrants ou l’effort de pêche, et veiller à maintenir et faire respecter une gestion des ressources fondée sur la science. La transparence des réponses politiques aidera à donner confiance dans l’avenir du secteur et des échanges en produits halieutiques et aquacoles, et permettra de tirer des enseignements de la crise afin d’améliorer la durabilité et la résilience de la pêche et de l’aquaculture.
Quelles répercussions la pandémie a-t-elle sur la pêche et l’aquaculture à l’échelle mondiale, et quelles sont les conséquences possibles ?
La modification de la consommation alimentaire et les difficultés d’acheminement jusqu’aux consommateurs ont des répercussions notables sur la demande et les prix
Les réponses en matière de santé publique à la pandémie de COVID-19 et les mesures connexes, du confinement et de la distanciation sociale aux contrôles plus stricts à la frontière et au trafic aérien réduit, ont des impacts importants et complexes sur la demande et les prix des produits halieutiques et aquacoles.
La demande du secteur de l’hôtellerie et de la restauration (HORECA) représente une part importante de la consommation de produits halieutiques et aquacoles dans de nombreux pays de l’OCDE. La fermeture des restaurants et l’annulation des événements publics et privés ont provoqué une chute de la demande de certains produits halieutiques et aquacoles, en particulier des produits haut de gamme, tels que le homard, les huîtres, le thon rouge et le coryphène (mahi-mahi).
La contraction de la demande intérieure est souvent aggravée par un effondrement des marchés d’exportation. Par exemple, l’annulation des festivités du Nouvel An lunaire en République populaire de Chine (ci-après la « Chine »), traditionnellement associées à la consommation de fruits de mer haut de gamme, a eu un effet dévastateur sur les pêches du homard en Australie, au Kenya, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis, entre autres.
Les mesures de distanciation sociale et de confinement ont également entraîné la fermeture de nombreux marchés des produits halieutiques et aquacoles à l’échelle mondiale, tandis que la fermeture des frontières et la réduction importante du fret aérien, associée à une hausse de son coût due à l’annulation des vols de passagers, ont donné un coup de frein supplémentaire aux échanges. Ces répercussions ont encore compliqué la vente de poisson frais, même lorsque la demande se maintient à l’échelle nationale et internationale.
Dans de nombreux endroits, la diminution de la demande et les difficultés d’acheminement de la marchandise aux consommateurs ont à leur tour entraîné une baisse et une volatilité accrue des prix. Les données de l’Observatoire européen des marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture, par exemple, révèlent une baisse des prix dans les pêcheries méditerranéennes allant de 20 % à 70 %, ainsi qu’une forte volatilité des prix hebdomadaires dans d’autres pêcheries européennes, l’évolution des prix variant fortement selon les produits et les pays. La forte baisse des prix et l’incertitude concernant les prix peuvent placer les pêcheurs dans une situation difficile (voir ci-dessous), même si, aux endroits où la baisse des prix donne la possibilité à davantage de personnes de consommer du poisson, ces tendances pourraient avoir des effets positifs en termes de bien-être pour les consommateurs.
La réduction de la demande de poisson frais s’accompagne d’une hausse de la demande de poisson en conserve, surgelé et transformé. La demande de ce type de produits dérivés du poisson de longue conservation a été principalement tirée par une hausse des ventes au détail des supermarchés, ainsi que par la constitution de stocks par les consommateurs (notamment au début de la pandémie). Par conséquent, l’industrie de la transformation du saumon et du corégone affiche des tendances positives par rapport à la même période l’année dernière, mais uniquement là où il n’y a pas eu de perturbation de la chaîne d’approvisionnement (traité ci-après).
En outre, à certains endroits, le COVID-19 a entraîné une hausse de la demande (et des prix) du poisson d’origine locale. Par exemple, les petits pêcheurs du lac Victoria, au Kenya, ont vu le prix de leurs prises augmenter, étant donné que l’offre de poisson congelé en filets habituellement importé de Chine a diminué. Dans plusieurs pays membres de l’OCDE, les organisations qui proposent des services de livraison directe mettant en relation les pêcheurs et les consommateurs se sont développées.
La demande de poisson pourrait repartir à la hausse avec l’allègement progressif des mesures de confinement par les pays. Le Viet Nam et la Thaïlande, par exemple, ont rouvert leurs restaurants fin avril. Cependant, dans de nombreux pays, notamment en Europe, les hôtels et les restaurants sont restés fermés lors des premières phases de réouverture, ou ne peuvent fonctionner qu’à capacité réduite. Les consommateurs pourraient également avoir besoin de temps pour atteindre les niveaux de consommation hors du foyer enregistrés avant la crise, même lorsqu’il sera à nouveau possible d’avoir une telle consommation. D’éventuelles deuxièmes vagues épidémiques localisées pourraient également entraîner de nouvelles mesures de confinement. Enfin, le repli économique provoqué par la pandémie et la diminution subséquente du pouvoir d’achat des consommateurs pourrait nuire à la demande à moyen et à long terme. Dans ces circonstances, la reprise de la demande risque d’être lente et difficile à prévoir.
La fermeture des marchés des produits halieutiques et aquacoles, la baisse de la demande des supermarchés, des restaurants et des autres circuits de distribution, de même que la préférence des consommateurs pour les livraisons sans contact, avec l’intervention d’un minimum d’intermédiaires pour des raisons de santé, ont accéléré le développement de services de commercialisation et de livraison à domicile plus directs pour les produits halieutiques et aquacoles.
Diverses approches de commercialisation de ce type, avec un minimum d’intermédiaires entre le pêcheur et le consommateur, existaient avant la crise du COVID-19. Ces services mettent en relation les pêcheurs et les consommateurs (p. ex., Poiscaille en France, Two Hands en Australie et JD Fresh en Chine) ou bien passent par des associations locales de pêcheurs, comme Get Hooked, une entreprise privée qui travaille directement avec les pêcheurs commerciaux de Santa Barbara. Des observations ponctuelles laissent penser qu’après une mise en pause initiale des activités, les ventes réalisées par ces services augmentent depuis avant la crise. La pandémie de COVID-19 a également stimulé la création de nouvelles entreprises ou associations telles que Call4Fish, qui a été créée par Plymouth Trawlers Agents et les poissonniers de la ville.
Nombre de ces services sont relativement nouveaux et globalement, ils ne représentent qu’une petite part du commerce de distribution du poisson. Cependant, leur développement est une tendance intéressante qui pourrait avoir des répercussions durables sur les chaînes d’approvisionnement en poisson en termes d’amélioration de la traçabilité et de baisse des coûts de gestion de l’hygiène, et encourager la consommation de poisson local, de saison et issu de sources durables. Ces approches pourraient également améliorer les bénéfices des pêcheurs et la résilience globale du secteur si les tendances de croissance actuelles se maintiennent après la pandémie.
Les mesures de santé et de sécurité supplémentaires et la mobilité réduite de la main-d’œuvre ont un effet négatif sur la capacité et les coûts de production tout au long de la chaîne d’approvisionnement
La diminution actuelle de la demande de poisson et les baisses de prix connexes, de même que l’incertitude concernant la durée de ces tendances, ont dissuadé les entreprises de produire dans de nombreux endroits. Les pêcheurs et les entreprises de pêche se sont abstenus de prendre la mer, ce qui provoque une forte baisse de la production, de l’ordre de 50 % pour les pêches françaises début avril par rapport à l’année précédente, et une réduction de 80 % du nombre de navires pêchant dans la Méditerranée. À l’inverse, les flottes de pêche de la Norvège et de la Russie semblent avoir continué à fonctionner presque normalement. Dans certains cas, du fait des pratiques de rémunération établies et du paiement préalable des salaires de l’équipage, des navires ont effectué les sorties prévues malgré les prix en baisse (et les risques pour la santé liés à la difficulté d’appliquer les mesures de distanciation sociale et d’hygiène sur les navires de pêche). La capacité d’adaptation à l’évolution de la demande dépend également des possibilités de stockage et de transformation. Les aquaculteurs semblent avoir été plus à même de maintenir la production et les ventes lorsqu’ils vendaient déjà aux supermarchés et étaient donc déjà habitués à respecter les exigences des produits transformés et préemballés (c’est le cas, par exemple, pour les éleveurs de bars et de dorades en Italie).
Les difficultés des producteurs liées à la baisse de la demande et des prix ont été accentuées par les mesures de santé publique nécessaires prises en réponse à la pandémie, qui ont réduit la capacité de production et fait augmenter les coûts tout au long des chaînes d’approvisionnement. Dans les installations de transformation du poisson à terre où, en général, de nombreux travailleurs se côtoient dans un espace confiné, la mise en place des mesures de distanciation sociale sans réduction du nombre de travailleurs est complexe sur le plan logistique, si ce n’est impossible. Ces difficultés peuvent être encore plus prononcées sur les navires de pêche. Les coûts supplémentaires découlent également de la nécessité de porter un équipement de protection individuelle (FAO, 2020[1]).
La production et la transformation du poisson à terre et les navires de pêche sont également vulnérables à la pandémie elle-même : l’apparition de foyers du virus a entraîné la fermeture d’installations au Chili et aux États-Unis. L’apparition du virus sur un navire de pêche pourrait avoir des conséquences encore plus graves, en particulier dans les flottes de grande pêche : les navires peuvent rester en mer plusieurs mois et il n’y a aucun traitement disponible immédiatement. Il y a également des risques pour les communautés locales lors du retour au port, étant donné que les navires pourraient être des vecteurs de la maladie dans des communautés éloignées et prolonger l’épidémie.
Les restrictions de la mobilité des personnes et les mesures de confinement ont également un impact sur la production, en particulier lorsque la législation nationale ne prévoit pas d’exemption des mesures de confinement pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture. Par exemple, en Inde, où l’aquaculture n’a pas été exemptée des mesures de confinement au départ, les écloseries de crevettes ont été forcées de détruire les stocks de semence non vendus. Au Pérou, le premier producteur de farine de poisson et l’un des plus gros producteurs d’huile de poisson à l’échelle mondiale, les installations de transformation ont de fait été fermées en raison des mesures nationales de confinement instaurées le 16 mars (et levées le 11 mai). Ces fermetures ont entraîné une hausse des prix en Chine, qui importe de grandes quantités de farine de poisson et d’huile de poisson pour les utiliser dans ses systèmes d’aquaculture.
La nature même de l’aquaculture signifie aussi qu’il peut être difficile de s’adapter à la modification de la demande et que des perturbations aux premières étapes du processus de production peuvent avoir des effets durables. Par exemple, les problèmes qui compromettent actuellement la production de semence se traduiront par une perturbation des approvisionnements en produits finaux dans les semaines et mois à venir. Les aquacultures peuvent aussi être obligées de garder le poisson plus longtemps que la durée optimale, ce qui fait augmenter les coûts de production et peut faire baisser les prix de vente si les produits finaux ne sont pas conformes aux préférences des consommateurs.
En outre, un certain nombre de processus de préproduction ou de postproduction sont devenus plus complexes, des protocoles et opérations portuaires à la transformation, ainsi que les processus associés aux échanges tels que les inspections des marchandises en lien avec les mesures sanitaires et phytosanitaires, les tests et la certification des produits.
Du fait de la nature internationale de nombreuses chaînes de valeur des produits halieutiques et aquacoles, le secteur est particulièrement vulnérable aux crises qui limitent la circulation transfrontalière des marchandises. Par exemple, la pêche de la crevette grise, produit qui est débarqué en Allemagne puis décortiqué au Maroc, a rencontré des difficultés logistiques importantes. Dans certains cas, une réorientation des échanges s’est produite, les flux commerciaux s’adaptant à l’évolution des mesures et des situations dans les pays. La capacité des entreprises de transformation à répondre à l’augmentation de la demande de produits tels que le thon en conserve dépend de la situation dans d’autres pays. Dans certains cas, il est possible de résoudre les perturbations des chaînes d’approvisionnement en remplaçant les matières premières des produits transformés par d’autres, mais cette substitution a un effet sur le prix et la qualité.
S’il est trop tôt pour évaluer l’impact de la crise sur les ressources naturelles, il est essentiel d’investir dans la surveillance
Selon la situation de chaque stock de poissons et de chaque écosystème, ainsi que de l’ampleur de la réduction de la pêche, la crise pourrait avoir des effets positifs sur l’état de certains stocks de poissons, ainsi que sur la biodiversité de manière plus générale. Cependant, il est nécessaire de recueillir davantage de données pour comprendre l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’effort de pêche mondial. De plus, la relation entre l’effort de pêche et l’état des stocks est parfois difficile à prévoir. Les répercussions possibles de la crise sur les stocks de poissons importants sur le plan commercial restent donc peu connues.
Ce qui est clair, en revanche, c’est que les répercussions dépendront également des réponses politiques à la crise, notamment de leur effet sur la pêche pendant la reprise. Cette crise offre l’occasion de déterminer si une réduction de la pression exercée par la pêche permet le rétablissement et l’augmentation des ressources naturelles. Cependant, des efforts concertés seront nécessaires à la fois pour poursuivre la collecte actuelle de données et pour examiner de nouvelles sources d’échanges de données et de renseignements sur les impacts de la crise. L’analyse des données satellite et de télédétection, de même que les renseignements recueillis par les différentes technologies de surveillance des navires, pourraient être des pistes prometteuses.
L’incidence potentielle sur la sécurité alimentaire mondiale et les revenus demande des réponses urgentes mais calibrées de la part des gouvernements et de l’industrie
La pêche et l’aquaculture fournissent des aliments nutritifs, riches en protéines animales et en nutriments essentiels, à des centaines de millions de personnes dans le monde entier chaque jour. Ces secteurs procurent des revenus à plus de 10 % de la population mondiale, pour beaucoup des femmes. La branche d’activité des fruits de mer est particulièrement importante pour la sécurité alimentaire et les revenus dans les zones côtières éloignées des pays en développement, notamment là où il n’y a pas de système de protection sociale. Les fruits de mer représentent une part importante des exportations totales de certains pays de l’Asie du Sud-Est, et quelques régions côtières de pays membres de l’OCDE sont aussi relativement dépendantes de cette branche.
Les risques pour l’emploi, les revenus et la sécurité alimentaire appellent les gouvernements (et l’industrie) à gérer de nombreuses demandes (répondre à la crise sanitaire, atténuer le choc pour le secteur et assurer le bon fonctionnement du système alimentaire) tout en continuant à poursuivre les objectifs essentiels à long terme liés à la protection et au rétablissement des ressources et des écosystèmes océaniques.
Le reste de cette note de politique suggère des réponses possibles à la crise. Cette note sera suivie d’une série de notes thématiques lorsque des données plus détaillées sur l’impact du COVID-19 et des renseignements sur les réponses politiques seront disponibles.
Comment l’intervention des gouvernements peut-elle atténuer les difficultés équitablement et efficacement tout en contribuant à l’utilisation durable des ressources et des écosystèmes?
Afin de maintenir la production de produits halieutiques et aquacoles et de répondre aux préoccupations concernant la sécurité alimentaire, les gouvernements peuvent exclure la production de ces produits des règles de confinement lorsque c’est possible (OCDE, 2020[2]). De telles mesures allégeraient également les difficultés des communautés côtières, qui dépendent fortement de ce secteur. Cependant, cela n’est peut-être pas possible partout et des mesures supplémentaires, comme un soutien temporaire aux revenus des pêcheurs et des travailleurs de la filière de transformation touchés, peuvent s’avérer nécessaires.
Il sera essentiel que les réponses politiques soient conçues et mises en œuvre de façon à apporter un soutien à ceux qui en ont besoin, sans encourager la pêche non durable (maintenant ou à l’avenir) ni créer les distorsions de marché de demain. En outre, il est primordial de maintenir et de faire appliquer un cadre réglementaire adapté pendant la crise actuelle et immédiatement après afin de garantir la durabilité à long terme du secteur, y compris pour les pêcheries internationales. Les réponses à la crise et les leçons qui en seront tirées pourraient également être l’occasion d’accélérer les transformations du secteur de la pêche et de l’aquaculture afin de renforcer sa résilience aux futurs chocs.
Les mesures de soutien devraient être conçues de façon à ne pas encourager la pêche non durable, aujourd’hui comme à l’avenir.
Il est important de concevoir et de mettre en œuvre adéquatement les mesures de soutien afin qu’elles bénéficient à ceux qui en ont le plus besoin tout en utilisant efficacement les rares ressources publiques. En général, l’OCDE recommande que les politiques de soutien des gouvernements en réponse à la pandémie de COVID-19 soient limitées dans le temps, ciblées, fondées sur des aides et cohérentes par rapport aux objectifs de durabilité à long terme (OCDE, 2020[3]). Étant donné que les pêches de capture dépendent des ressources naturelles, la conception et la mise en œuvre de mesures de soutien spécifiques ont également des conséquences directes pour la pêche et la durabilité des ressources à long terme. Comme le souligne l’Objectif de développement durable 14 adopté par les Nations Unies et comme il a été mentionné dans les négociations en cours au sein de l’Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche, il est important de s’assurer que les politiques de soutien n’encouragent pas la surpêche, la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, ainsi que d’autres pratiques de pêche susceptibles de détruire les écosystèmes océaniques et de compromettre la durabilité des ressources. Heureusement, les considérations relatives à l’économie, à l’équité et à l’environnement suggèrent toutes des pratiques exemplaires similaires en termes de soutien à la pêche.
Les travaux de l’OCDE, notamment, montrent que les politiques qui réduisent le coût des intrants, comme le subventionnement du carburant ou les aides à la construction ou à la modernisation des navires, sont parmi les plus susceptibles d’inciter les pêcheurs à intensifier leur activité et d’encourager la pêche non durable, tout en aboutissant à des résultats moins inclusifs du fait qu’elles favorisent les grandes entreprises de pêche au détriment des petites (Martini et Innes, 2018[4]). En 2017, les politiques de ce type ont représenté 40 % du soutien direct aux personnes et aux entreprises du secteur de la pêche déclaré par les 27 pays de l’OCDE qui ont participé à la base de données Estimation du soutien aux pêcheries de l’OCDE1. Les données recueillies à ce jour laissent penser que globalement, les pays ne versent pas de nouvelles subventions aux intrants en réponse à la pandémie de COVID-19, peut-être du fait de la baisse récente du prix du carburant. Cependant, étant donné que les pertes du secteur augmentent et que les gouvernements sont pressés de fournir un soutien supplémentaire, cette tendance pourrait évoluer. Il est donc important de rappeler que l’objectif devrait être d’abandonner ce type de mesures et d’apporter plutôt un soutien direct aux revenus avec des transferts monétaires ciblés, lorsque c’est nécessaire, ce qui profitera à l’environnement et à la durabilité du secteur, en plus d’améliorer les moyens de subsistance des pêcheurs.
Le soutien direct peut être en partie découplé des activités de pêche, par exemple en instaurant des systèmes de soutien aux revenus et d’assurance spéciale. Ce type d’approches est apprécié des gouvernements : outre les plans généraux de relance, des mesures de soutien des revenus propres au secteur de la pêche sont mises en œuvre au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et au Japon, entre autres2. Au sein de l’Union européenne (UE), ces programmes profitent de la modification de la réglementation de l’UE relative aux aides d’État : les plafonds ont été doublés dans certains cas et atteignent 120 000 EUR (130 360 USD)3 et les règles d’utilisation du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) ont été assouplies. En Corée, le gouvernement a mis de côté 3 milliards KRW (2.4 millions USD) pour accorder des prêts à faible taux d’intérêt (1.3 %) aux aquaculteurs et aux entreprises de pêche confrontées à des problèmes de trésorerie en raison du COVID-19. Les gouvernements ont également recours aux exonérations et aux reports de paiement pour réduire les coûts assumés par les pêcheurs. Par exemple, en Australie, l’ensemble des frais applicables aux pêcheries du Commonwealth en 2020 a été supprimé. De même, au Canada, la Commission des prêts aux pêcheurs et aux aquaculteurs de la Nouvelle-Écosse a reporté l’ensemble des frais à la fin du mois de juin.
Des avantages peuvent également être accordés en échange d’une réduction temporaire ou permanente de la capacité, par exemple des dispositifs de désarmement ou des paiements pour les départs à la retraite anticipés. La crise a entraîné la modification temporaire du FEAMP, autorisant les États membres de l’UE à dédommager les pêcheurs et les aquaculteurs qui réduisent ou arrêtent leur production. L’Irlande, par exemple, propose actuellement un dispositif fondé sur le volontariat qui est destiné à aider les propriétaires de navire à assumer les coûts fixes tant que leur flotte est immobilisée, qui sera en vigueur de juin à août4. Ces efforts peuvent aider à stabiliser les prix et à réduire l’offre excédentaire sur des marchés déprimés. Ces mesures sont aussi parfois utilisées dans l’optique de préserver la disponibilité des quotas pour plus tard. Pour qu’elles donnent lieu à une réduction à long terme de la pression de la pêche et, à terme, à une amélioration de l’état des stocks de poissons, elles doivent donc être mises en œuvre de manière à ne pas permettre de recapitalisation de la flotte, et non pas se contenter, dans les faits, de reporter l’effort de pêche.
En plus du soutien direct aux personnes et aux entreprises, les gouvernements peuvent financer des services au secteur de la pêche qui bénéficient à l’ensemble du secteur ou à des segments de celui-ci. Les services qui ciblent la capacité des pêcheurs à exploiter leur entreprise en encourageant la diversification des marchés peuvent s’avérer utiles dans le contexte actuel. C’est particulièrement important pour les pays dont la production de produits halieutiques et aquacoles est en grande partie axée sur les exportations, et qui ont donc été particulièrement touchés par la crise du COVID-19. Des initiatives visant à appuyer le développement de nouveaux marchés et la promotion de la consommation de fruits de mer à l’échelle nationale ont été mises en œuvre par les gouvernements en Australie, au Japon, au Royaume-Uni, au Chili, en Chine, au Pérou, en Thaïlande et en Indonésie.
À plusieurs endroits, ces efforts ont été accompagnés d’un soutien au fret aérien afin de maintenir d’importantes voies d’acheminement internationales de produits à forte valeur ajoutée tels que la langouste en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui ont payé un tribut excessivement lourd à l’effondrement du transport aérien. Le secteur halieutique et aquacole profite également de mesures plus générales prises en vue de faciliter les processus liés aux échanges et les formalités aux frontières, comme l’acceptation des versions numériques des certificats exigés ou bien un dédouanement des produits alimentaires 24 h/24 et 7 j/7 dans les grands ports (OCDE, 2020[5]).
Par ailleurs, les États renforcent les dispositifs de soutien destinés à aider les pêches à compenser les pertes de demande. Des campagnes de promotion de la consommation de produits halieutiques et aquacoles locaux ont été organisées dans de nombreux pays ; au Costa Rica, par exemple, elles se sont doublées d’un soutien aux programmes de vente directe5. Des fonds sont également affectés aux initiatives de rééquilibrage des marchés tels que l’achat, le transport et le stockage d’espèces subissant une forte baisse de la demande et des prix en raison du COVID-19 : au Japon, par exemple, quelque 30 millions USD ont été réservés aux mesures de ce type. Le retrait temporaire de la production du marché, notamment en recourant au stockage frigorifique, est important pour les produits aquacoles dont la demande a diminué, mais dont la production ne peut pas être ralentie ou arrêtée facilement. Ces efforts contribueront également à réduire la perte et le gaspillage de produits halieutiques et aquacoles tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
Bon nombre des programmes actuellement adoptés ont une durée limitée. Par exemple, au Royaume-Uni, le fonds de contribution de 9 millions GBP (11.1 millions USD) pour la pêche est actuellement limité à trois mois, et les modifications apportées au FEAMP expirent fin 2020. Il est capital que les programmes de soutien destinés à compenser l’impact du COVID-19 sur les revenus des acteurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture ne deviennent pas des droits permanents, car ils risqueraient d’accroître la pression de la pêche et de provoquer une concurrence déloyale.
Les répercussions de la pandémie varieront probablement significativement selon les pays et même au sein des pays eux-mêmes, en fonction des communautés, des pêches et des chaînes de valeur. Afin de cibler les aides sur ceux qui en ont le plus besoin, il est essentiel que les gouvernements continuent d’investir dans la surveillance des répercussions économiques et sociales sur les systèmes de production de la pêche et de l’aquaculture, les chaînes d’approvisionnement connexes et les habitudes de consommation des produits halieutiques et aquacoles.
Enfin, il est important de rappeler que les politiques de soutien procurent généralement plus d’avantages aux pêcheurs et sont moins susceptibles d’encourager la pêche non durable lorsqu’un système de gestion performant est en place (en particulier avec un total admissible de capture) (Martini et Innes, 2018[4]). Il est impératif de comprendre l’impact de la pandémie sur les systèmes de gestion des pêches et les pays devront aussi continuer à investir dans une gestion des stocks fondée sur des données scientifiques et dans la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée.
Les politiques de gestion des pêches doivent continuer à se fonder sur la science malgré une pression croissante exercée en faveur d’une compensation des pertes, ainsi que des difficultés pratiques dans le suivi et la surveillance des activités de pêche
Il ne s’agit pas uniquement de s’assurer que les ressources publiques sont utilisées avec discernement pour aider le secteur de la pêche à traverser la crise. La durabilité du secteur sur les plans environnemental, économique et social dépend également du maintien et de l’exécution d’un cadre réglementaire approprié. Ces aspects pourraient être difficiles à mettre en œuvre dans les mois à venir. Les décideurs seront pressés de compenser les pertes lors de la reprise, en particulier lorsque d’autres facteurs affectent les possibilités de pêche, comme la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Il est généralement plus efficace de compenser directement les pertes de revenus dues à des possibilités de pêche manquées (dans la mesure du possible), mais les gouvernements chercheront probablement des solutions peu coûteuses pour atténuer les difficultés économiques et financières. L’assouplissement des restrictions applicables à la pêche peut être considéré comme une option préférable au versement de fonds. Des modifications de la gestion ont déjà été mises en œuvre dans un certain nombre de pays, dont un élargissement des zones et des campagnes de pêche, ainsi que des reports de quotas.
Toutefois, cette modification des règles de gestion peut ne pas être souhaitable si elle compromet les aspects liés à la durabilité des règles initiales. Ces modifications pourraient en effet accroître la pression sur les stocks à une période potentiellement cruciale, en particulier lorsque cette pression est déjà trop forte, avec d’éventuelles conséquences durables sur l’abondance des stocks de poissons, les prises et la production de revenus. Étant donné la complexité de la relation entre l’effort de pêche et l’état des stocks de poissons, et l’augmentation de la pression sur les pêches découlant du changement climatique, les pays devraient maintenant, plus que jamais, adopter une approche prudente et fondée sur des preuves de la modification de la gestion.
Une telle approche s’avérera d’autant plus importante que les obligations de distanciation sociale font obstacle à la surveillance et l’application de la loi, ce qui a déjà entraîné, par exemple, la levée des obligations concernant les observateurs des pêches6 dans plusieurs régions7. Les obligations concernant les observateurs ont notamment été levées dans des pêcheries nationales (par exemple, pour 45 jours au Canada) et des pêcheries internationales (p. ex., par la Commission des pêches du Pacifique occidental et central jusqu’au 31 juillet). L’absence d’observateurs représente une opportunité pour les exploitants sans scrupules de pratiquer la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, notamment dans des parties du monde où la capacité de surveillance et d’application de la loi est faible. La baisse des recettes publiques tirées des taxes propres au secteur découlant du report des paiements, par exemple, pourrait également réduire le budget de gestion, de contrôle et de surveillance.
Les pays peuvent essayer de compenser ces impacts en renforçant et en soutenant les activités de surveillance à distance et en accélérant l’adoption de solutions technologiques, ce qui réduit le besoin d’observation en personne. L’utilisation obligatoire des systèmes de surveillance des navires (SSN)8 ou des systèmes d’identification automatique9, qui surveillent les endroits où pêchent les navires, peut faciliter la mise en œuvre effective des fermetures de zones, y compris des restrictions concernant la présence des navires dans les aires marines protégées (AMP), ainsi que les règlements temporaires, comme les fermetures saisonnières. Les systèmes de documentation des captures et la vérification des journaux de bord des captures, dans lesquels sont consignés les détails de l’activité de pêche entreprise, peuvent également contribuer à faire respecter la réglementation sur la taille et la composition des captures au débarquement. Ces exigences étaient universelles pour l’exploitation commerciale dans les pays membres de l’OCDE examinés en 2016, ainsi que pour les navires pêchant sous la responsabilité d’organisations régionales de gestion des pêches (Hutniczak, Delpeuch et Leroy, 2019[6] ; Hutniczak, Delpeuch et Leroy, 2019[7]). L’élargissement de ces exigences chaque fois que possible, y compris dans le cadre d’une coopération pour le développement, devrait être une priorité pour maintenir la surveillance et le contrôle pendant la crise et éviter une brusque hausse de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée.
Il peut être encore plus difficile de maintenir en place une gestion, un contrôle et une surveillance appropriés pour les pêches gérées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP). L’annulation et le report des réunions des ORGP pourraient nuire à la coopération internationale et réduire la transparence, en particulier si cela retarde l’adoption de mesures nécessaires et la réalisation indépendante des examens des parties. Les pays devraient s’employer ensemble à minimiser les répercussions du COVID-19 sur les activités des ORGP et sur la gestion des pêches internationales.
La transparence des réponses politiques et la coopération régionale et internationale restent essentielles à une bonne gestion des pêches
La transparence des réponses politiques est primordiale pour instaurer le climat de confiance dont les gouvernements ont besoin sur leur territoire et à l’étranger afin de stimuler la confiance dans les échanges et les marchés mondiaux, de gérer les attentes commerciales et de conserver un soutien politique concernant l’utilisation des fonds publics (OCDE, 2020[8]).
Il est également capital que les pays fournissent des informations transparentes sur leurs réponses politiques à la crise, aujourd’hui et lorsque la crise se résorbera, afin de tirer des leçons de l’expérience des autres et ainsi mieux préparer le futur.
Les négociations en cours à l’OMC sont actuellement compliquées par la restriction des déplacements, mais il n’en demeure pas moins essentiel de parvenir à un accord international sur la suppression progressive des politiques de soutien aux pêches néfastes. Néanmoins, les pays peuvent aussi progresser indépendamment et mettre en œuvre les propositions de réduction des mesures de soutien préjudiciables sans attendre qu’un accord soit conclu.
Afin de contribuer à ce besoin d’informations transparentes, l’OCDE suit les mesures de soutien et les changements apportés à la gestion des pêches dans le contexte de la crise du COVID-19. À ce jour, 76 mesures de soutien gouvernementales, 29 changements apportés à la gestion des pêches et 14 modifications apportées à la réglementation relative aux chaînes d’approvisionnement ont été recensés par l’OCDE. En se fondant sur ces informations et sur la surveillance, l’OCDE s’emploiera, avec d’autres organisations, à soutenir les gouvernements en leur fournissant des preuves et des analyses opportunes et objectives afin d’éclairer les choix stratégiques. Tous les gouvernements sont invités à communiquer des renseignements sur les dispositions prises pour les secteurs de la pêche et de l’aquaculture (les personnes à contacter sont indiquées à la fin de cette note).
Références
[1] FAO (2020), Effets de la covid-19 sur les systèmes alimentaires halieutiques et aquacoles, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Rome, http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA8637FR.
[6] Hutniczak, B., C. Delpeuch et A. Leroy (2019), Closing Gaps in National Regulations Against IUU Fishing, Éditions OCDE, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9b86ba08-en.
[7] Hutniczak, B., C. Delpeuch et A. Leroy (2019), Intensifying the Fight Against IUU Fishing at the Regional Level, Éditions OCDE, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/b7b9f17d-en.
[4] Martini, R. et J. Innes (2018), Relative Effects of Fisheries Support Policies, Éditions OCDE, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/bd9b0dc3-en.
[8] OCDE (2020), COVID-19 and International Trade: Issues and Actions, Éditions OCDE, https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128542-3ijg8kfswh&title=COVID-19-and-international-trade-issues-and-actions.
[2] OCDE (2020), COVID-19 and the Food and Agriculture Sector: Issues and Policy Responses, Éditions OCDE, https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=130_130816-9uut45lj4q&title=Covid-19-and-the-food-and-agriculture-sector-Issues-and-policy-responses&utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Read%20the%20brief&utm_campaign=Agriculture%20COVID%20blast&utm_t.
[3] OCDE (2020), Government Support and the COVID-19 Pandemic, Éditions OCDE, https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128572-w5qyf5699d&title=Government-support-and-the-COVID-19-pandemic.
[5] OCDE (2020), Trade Facilitation and the COVID-19 Pandemic, Éditions OCDE, https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=130_130609-v8jn83j1j3&title=Trade-facilitation-and-the-covid-19-pandemic.
[11] OCDE (2019), Des emplois de qualité pour tous dans un monde du travail en mutation : La stratégie de l’OCDE pour l’emploi, Éditions OCDE, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/4e6a92fa-fr.
[10] OCDE (2014), « La crise et ses retombées : les sociétés et les politiques sociales mises à l’épreuve », dans Panorama de la société 2014 : Les indicateurs sociaux de l’OCDE, Éditions OCDE, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/soc_glance-2014-5-fr.
[9] OCDE (2010), Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2010 : Sortir de la crise de l’emploi, Éditions OCDE, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/empl_outlook-2010-fr.
Pour en savoir plus
Cette note inaugure une série de notes de politique consacrées aux enjeux liés au COVID-19, à la pêche et à l’aquaculture. Restez à l’affût des autres notes de politique de cette série qui examineront plus en détail des questions précises sur la page http://www.oecd.org/fr/agriculture/sujets/peche-et-aquaculture/. D’autres notes de politique sont disponibles sur la page http://oecd.org/coronavirus/fr/.
Notes
La base de données Estimation du soutien aux pêcheries (FSE) de l’OCDE évalue de façon systématique et transparente les politiques de soutien du secteur de la pêche mises en œuvre par l’ensemble des pays membres de l’OCDE et des autres économies où la pêche est importante. La base de données FSE et les travaux de modélisation associés permettent d’étudier les impacts des politiques de soutien au secteur sur les ressources et les écosystèmes, ainsi que sur les emplois, les revenus et la création de valeur, dans l’optique d’aider les décideurs à ajuster les politiques afin d’atteindre les objectifs déclarés.
Dans de nombreux pays, des plans de relance économique incluant des subventions, des prêts à taux zéro, des garanties salariales et des mesures macrofiscales sont utilisés pour protéger les emplois et les revenus dans l’ensemble des secteurs économiques, y compris la pêche et l’aquaculture. Cependant, dans de nombreux cas, les opérateurs de la pêche favorisent des structures organisationnelles qui sont rares dans d’autres secteurs, comme le partage des revenus entre les membres de l’équipage du navire, structure qui peut être exclue des systèmes d’indemnisation pour des raisons techniques. En outre, le caractère saisonnier du travail, l’emploi de membres d’équipage et de travailleurs saisonniers étrangers sur les navires, et la part relativement élevée d’activités informelles et de travailleurs indépendants signifient que les plans généraux de relance peuvent ne pas être aussi efficaces pour la pêche et l’aquaculture. Le contexte national du secteur et la façon dont celui-ci réagit aux effets complexes et difficiles à prévoir de la pandémie de COVID-19 permettront de déterminer si des programmes de soutien propres à la pêche sont nécessaires et leur portée.
Les aides d’État doivent être découplées, ce qui, dans ce cas, signifie « non fixées selon le prix ou la quantité des produits mis sur le marché ».
Les observateurs des pêches sont des spécialistes indépendants employés par les organismes gouvernementaux pour surveiller les activités des navires.
Les fermetures des frontières ont encore exacerbé ces problèmes, car il est devenu difficile de rapatrier les observateurs après une sortie en mer.
Les SSN sont utilisés dans les pêches commerciales pour permettre aux organismes de réglementation de suivre les activités des navires de pêche. Les caractéristiques fonctionnelles du système et du matériel associé varient selon les exigences imposées par la réglementation relative à la pêche de la zone dans laquelle opère le navire. Les systèmes sont gérés à l’échelle régionale ou nationale, et l’accès aux données est limité. Cependant, certains pays comment à opter pour la transparence des données des SSN.
Adopté en 2000 par l’Organisation maritime internationale (OMI), le système d’identification automatique a initialement été conçu pour assurer la sécurité de la navigation et éviter les collisions de navires. Les navires équipés de transpondeurs SSN émettent des informations sur leur identité, leur position et leur trajectoire. Le flux de données en temps réel générées sur la position des navires donne une bonne idée des activités normales des navires, ce qui peut également orienter la gestion du trafic et de la surveillance côtière. À l’aide d’algorithmes élaborés par un système d’apprentissage automatique, il est possible d’évaluer les données du système d’identification automatique pour repérer d’éventuelles irrégularités, ce qui aide à détecter les activités de pêche illégale, non réglementée et non déclarée (d’autant plus que les données du système d’identification automatique ne sont pas soumises à une obligation de confidentialité et peuvent être achetées aux vendeurs des données).