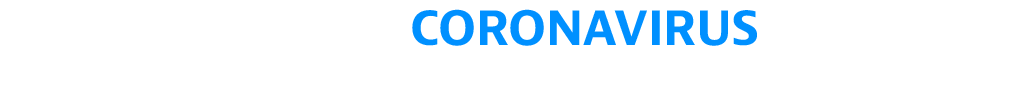Abstract
La pandémie de COVID‑19 et les mesures qui ont été prises par les États pour y faire face et limiter les déplacements ont eu un impact sur les modes et les lieux de consommation d’alcool. Si le chemin de la reprise reste encore long et difficile, cette crise accroît également le risque de boire avec excès pour faire face au stress. Depuis le début de la pandémie, les violences domestiques –pour lesquelles la consommation nocive d’alcool est un facteur de risque- s’accroissent.
La consommation nocive d'alcool nuit à la santé, provoque des maladies et des blessures, affaiblit les mesures de lutte contre le COVID‑19 et entraîne des coûts économiques et sociaux importants. Des ensembles exhaustifs de mesures s’appuyant sur une approche de type « PPPP » (politiques de Prix, actions des services de Police pour lutter contre la conduite en état d’ivresse, services de soins Primaires à l’écoute des gros buveurs, réglementation des activités de Promotion de l’alcool) permettent d’améliorer l’état de santé et de soutenir une reprise économique et sociale plus vigoureuse après la pandémie.
Pendant la pandémie de COVID‑19, les habitudes de consommation d’alcool ont profondément changé, passant des bars et restaurants au domicile. Pour beaucoup, l’alcool fait partie de la vie sociale, vie qui a été considérablement perturbée par la crise du COVID‑19. Dans l’ensemble, la quantité d’alcool consommé n’a pas évolué, mais lorsque cela a été le cas, l’évolution s’est faite plus souvent à la hausse. Si l’on examine les données préliminaires sur les recettes fiscales publiques, les ventes d’alcool ont augmenté de 3 % à 5 % en Allemagne, aux États-Unis et au Royaume-Uni en 2020 par rapport à 2019. Les ventes d’alcool dans les bars et les restaurants se sont effondrées, ce qui a eu de graves répercussions sur ce secteur, tandis que les ventes hors débits de boisson, comme le commerce en ligne et les magasins de détail, ont fortement augmenté. Aux États-Unis, par exemple, les ventes en ligne ont fait un bond de 234 %.
Certains des problèmes liés à la consommation nocive d’alcool ont été aggravés par la crise, même si les effets à long terme de la pandémie de COVID‑19 sur la consommation d’alcool restent incertains. Durant les périodes de confinement, ce sont les femmes, les parents de jeunes enfants, les hauts revenus et les individus présentant des symptômes de dépression et d’anxiété qui ont fait état des plus fortes hausses de consommation d’alcool, par exemple en Australie, en Belgique, aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni. Les appels d’urgence pour violences domestiques, dont on sait que la consommation nocive d’alcool est un facteur de risque, ont augmenté de 60 % dans les États membres de l’UE. Il est également à craindre que la crise n’entraîne une hausse de la consommation excessive d’alcool à moyen terme, dans la mesure où ce type de comportement est fréquent après des événements traumatiques en réaction à des niveaux de stress élevés.
La consommation nocive d’alcool pèse lourdement sur la population, l’économie et la société. En moyenne dans les pays de l’OCDE, au cours des 30 prochaines années, les maladies et les blessures causées par la consommation quotidienne de plus d’un verre d’alcool pour les femmes et d’un verre et demi pour les hommes (correspondant à un seuil à moindres risques spécifiquement utilisé pour la simulation) feront que l’espérance de vie sera inférieure de 0.9 an à ce qu’elle aurait été autrement. Ils seront également responsables d’environ 2.4 % des dépenses totales de santé et le PIB sera inférieur de 1.6 % à ce qu’il aurait dû être, en raison de taux d’activité et de productivité plus faibles.
Les pouvoirs publics disposent de toute une batterie de mesures pour lutter contre la consommation nocive d’alcool et prévenir les maladies connexes. Un ensemble de mesures reposant sur une approche « PPPP », comprenant des services de Police pour lutter contre la conduite en état d’ivresse, le renforcement des services de soins Primaires à l’écoute des gros buveurs, la réglementation de la Promotion de l’alcool, notamment l’interdiction de la publicité pour l’alcool auprès des enfants, et des politiques de Prix visant en particulier l’alcool bon marché, permettrait de prévenir les maladies et les blessures, d’allonger l’espérance de vie et de générer des économies supérieures aux coûts de mise en œuvre.
La prévention des maladies et des blessures liées à l’alcool présente un triple intérêt. Premièrement, réduire sa consommation d’alcool aide à résister aux infections et à renforcer son système immunitaire après la vaccination. Deuxièmement, la prévention de la consommation d’alcool et des maladies qui lui sont associées réduit la pression sur les services de santé - qui sont déjà soumis à de fortes tensions du fait de la pandémie de COVID‑19. Enfin, la prévention de la consommation nocive d'alcool favorise une population en meilleure santé et plus productive, et donc la relance de l’activité économique et de la vie sociale au sortir de la pandémie. Il est particulièrement important d’investir dans la protection des enfants et des personnes souffrant de problèmes d’alcool pendant cette période. Des services de soins primaires assurant l’accompagnement des gros buveurs, une réglementation de la publicité ou de la promotion des boissons alcoolisées à la télévision, sur internet et sur les réseaux sociaux ciblant les enfants, ainsi que des politiques de prix unitaires minimums pour les boissons alcoolisées bon marché, sont particulièrement adaptés pour répondre à certains des aspects prioritaires de la politique à l’égard de l’alcool pendant la pandémie de COVID‑19.
La pandémie de COVID‑19 a profondément modifié le mode de vie des individus, notamment leurs habitudes de consommation
La pandémie de COVID‑19 a modifié le mode de vie des individus, notamment leurs habitudes de consommation d’alcool. Les mesures publiques souvent strictes visant à contenir la propagation du virus ont généralement permis de maintenir la population chez elle. Ainsi, 39 % des travailleurs dans l’OCDE ont opté pour le télétravail (OCDE, 2020[1]) et des millions d’enfants ont dû suivre leur scolarité en ligne ou à la maison avec leurs parents. Les loisirs ont également subi des modifications, se traduisant par exemple par une forte augmentation du temps passé en ligne. Les habitudes de consommation - quantité, fréquence et lieu de consommation d’alcool - ont également changé. En particulier, les données les plus récentes mettent en lumière les éléments suivants :
Dans l’ensemble, la quantité d’alcool consommé n’a pas évolué, mais lorsque cela a été le cas, l’évolution s’est faite plus souvent à la hausse. Les résultats d’une enquête1 menée en Allemagne, en Australie, en Autriche, au Brésil, aux États-Unis, en France, en Irlande, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, en Suisse et au Royaume-Uni entre mai et juin 2020 (Winstock et al., 2020[2]) montrent que 36 % des personnes interrogées ont augmenté leur consommation d’alcool, 22 % l’ont diminuée et 42 % ne signalent pas de changement.
On observe également une légère augmentation des achats d’alcool dans les données publiques de suivi des ventes, du moins dans les pays où ces données sont disponibles. Au Royaume-Uni, par exemple, l’ensemble des recettes fiscales sur les boissons alcooliques ont augmenté de 4.5 % entre avril et octobre 2020 par rapport à la même période de l’année précédente (données non corrigées de l’inflation) (HM Revenue and Customs, 2020[3]). De même, les données tirées de 15 États américains montrent une hausse de 4 % de la quantité d’alcool vendue entre janvier et août 2020, par rapport à la même période en 2019 (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 2020[4]). Les données sur l’Allemagne révèlent une augmentation des recettes fiscales sur les boissons alcooliques de 3.3 % en 2020 par rapport à 2019 (Ministère fédéral des Finances, 2021[5]). La constitution de réserves dans les premières phases de la pandémie a peut-être aussi contribué à cette évolution.
La fréquence de consommation a augmenté, mais celle de la consommation excessive d'alcool n'a guère évolué. Dans les 11 pays pour lesquels des données sont disponibles, 43 % des individus ont déclaré boire de l’alcool plus fréquemment, contre un quart des adultes qui ont réduit leur fréquence de consommation. La probabilité de suralcoolisation occasionnelle (boire plus de 80 % d’une bouteille de vin ou 1.5 litre de bière en une seule occasion) n’a pas varié pour près de la moitié de la population. Environ 29 % des personnes interrogées signalent des épisodes moins fréquents de suralcoolisation occasionnelle, mais 23 % sont dans la situation inverse.
Alors que le secteur de l’hôtellerie, des bars et des restaurants a été durement touché par la crise, d’autres secteurs, comme les magasins de détail et le commerce en ligne, ont vu leurs ventes augmenter. Les ventes d'alcool dans les bars, les pubs, les restaurants et les discothèques ont chuté en raison des périodes de confinement. En revanche, la consommation d’alcool à domicile a augmenté, avec une hausse sensible des ventes dans les magasins de détail ou en ligne. Par exemple, les ventes hors des débits de boisson en Belgique, en Espagne et aux États-Unis ont enregistré une forte croissance (Eurocare, 2020[6] ; Nielsen, 2020[7]). Les ventes en ligne d’alcool ont progressé en Afrique du Sud, en Allemagne, en Australie, au Brésil, au Canada, en Chine, en Colombie, aux États-Unis, en Espagne, en France, en Inde, en Italie, au Japon, au Mexique, en Pologne, au Royaume-Uni, en Russie, en Thaïlande et en Turquie (IWSR, 2020[8]) - de 234 % pour ce qui est des États-Unis (Nielsen, 2020[7]).
La crise a accentué certains des problèmes liés à la consommation nocive d’alcool
Certains groupes de population ont, plus que d’autres, accru leur consommation d’alcool
Les comportements dangereux, comme la consommation d’alcool chez les mineurs, l’excès de boisson ou la suralcoolisation occasionnelle, sont très répandus dans certaines catégories de la population - tendance que les restrictions liées au COVID‑19 n’ont fait qu’accentuer. Avant la crise du COVID‑19, au moins un épisode mensuel de suralcoolisation occasionnelle (boire plus de 80 % d’une bouteille de vin ou 1.5 litre de bière en une seule occasion) était habituel chez un adulte sur trois en moyenne dans les pays de l’OCDE, les femmes hautement qualifiées ainsi que les bas et hauts salaires étant particulièrement exposés à ce risque (OCDE, 2021[9]). En outre, l’alcool est consommé de façon disproportionnée par une minorité d’individus : ceux qui boivent à l’excès (les hommes et les femmes consommant respectivement plus de 40 et 20 grammes d’alcool pur par jour) représentent entre 4 % et 14 % de la population selon les pays mais consomment entre un tiers et la moitié de tout l’alcool consommé, selon une analyse de six pays de l’OCDE (OCDE, 2021[9]).
Durant les périodes de confinement, ce sont les femmes, les parents de jeunes enfants, les personnes d’âge moyen, les hauts revenus et les individus présentant des symptômes de dépression et d’anxiété qui ont fait état des plus fortes hausses de consommation d’alcool, par exemple en Australie, en Belgique, aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni. À moyen terme, la crise du COVID‑19 risque d’entraîner une hausse de la consommation excessive d’alcool. L’augmentation de la consommation d’alcool est fréquente après des événements traumatiques, et une consommation excessive d’alcool peut découler de niveaux de stress élevés. Incontestablement, la pandémie de COVID‑19 a perturbé les individus et les populations partout dans le monde, créant les conditions d'une détresse physique et psychologique durable, et augmentant le risque d’une consommation plus grande d’alcool, même lorsque la crise sera finie.
Les violences domestiques ont augmenté
La consommation nocive d’alcool est responsable de blessures, dues notamment à des accidents de la route et à des actes de violence, et elle constitue, entre autres, un facteur de risque de violences conjugales et de maltraitance des enfants. Le rapport Prévenir la consommation nocive d’alcool montre que la consommation quotidienne de plus d’un verre pour les femmes et d’un verre et demi pour les hommes (correspondant à un seuil à moindres riques) entraînera 37 millions de cas de blessures au cours des 30 prochaines années dans 52 pays, soit 4 % de l’ensemble des blessures survenant dans ces pays (OCDE, 2021[9]). En termes de coûts de traitement, cette consommation d’alcool sera responsable d’environ 4 % de l’ensemble des dépenses consacrées au traitement des blessures.
Si le nombre d’accidents de la route a diminué (OCDE/FIT, 2020[10]), les périodes de confinement et le maintien à domicile ont exacerbé certains des comportements dangereux associés à une consommation excessive d’alcool, comme les violences domestiques. Près d'une femme sur trois subira des violences physiques et/ou sexuelles au cours de sa vie, et un enfant sur trois subit une forme de violence de la part de ses parents ou d’autres membres de sa famille (OMS, 2021[11]). Pendant la pandémie, le nombre d'appels d'urgence à des lignes d'assistance téléphonique pour signaler des actes de violence domestique a augmenté dans des pays comme l'Autriche, l'Espagne, l'Italie, le Mexique et le Royaume-Uni, pour n'en citer que quelques-uns (Silverio-Murillo, Balmori de la Miyar et Hoehn-Velasco, 2020[12]). Dans les États de l’UE, les appels d’urgence concernant des violences domestiques ont augmenté de 60 % (Mahase, 2020[13]).
La consommation nocive d’alcool est néfaste pour la santé et représente un coût considérable pour l’économie et la société
Pour beaucoup, la consommation d’alcool est une partie agréable de la vie sociale. Du fait des confinements et des restrictions mis en place pour lutter contre la pandémie de COVID‑19, la vie sociale a été fortement perturbée et le secteur de l’hôtellerie et de la restauration a été durement éprouvé. Néanmoins, la consommation nocive d’alcool reste dangereuse pour la santé des personnes et coûteuse pour la société dans son ensemble, comme l’explique l’OCDE dans son récent rapport intitulé Prévenir la consommation nocive d’alcool (OCDE, 2021[9]).
Diminution de l’espérance de vie
La consommation d’alcool représente un facteur de risque majeur pour certaines maladies chroniques, comme l’alcoolisme, la cirrhose, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers et les blessures. Selon les estimations de l’OCDE (qui datent d’avant la pandémie de COVID‑19), au cours des 30 prochaines années dans 52 pays, une consommation quotidienne supérieure à 1/1.5 verre entraînera environ 1.1 milliard de nouveaux cas de dépendance à l’alcool (soit 88 % de tous les cas), 37 millions de cas de blessures (4 %), 5 millions de cas de cirrhose (38 %), 10 millions de cas de cancers liés à l’alcool (4 %) et plusieurs millions de cas d’autres maladies.
Les maladies et blessures liées à l’alcool entraînent une diminution de l’espérance de vie de près d’un an à horizon 30 ans en moyenne dans les pays de l'OCDE et de l'UE (Figure 1). À titre de comparaison, au cours des 30 dernières années, l’espérance de vie dans les pays de l’OCDE a augmenté de 6.7 ans environ (Banque mondiale, 2020[14]). La consommation d’alcool n’est qu’un des déterminants de l’état de santé de la population, mais le fait de boire moins de 1/1.5 verre par jour contribuerait à hauteur de 13 % environ à la progression totale de l’espérance de vie enregistrée au cours d’une même période par le passé. Ce sont les pays d’Europe centrale et orientale qui devraient connaître le plus fort recul de l’espérance de vie.

Note : ces résultats sont obtenus en comparant un scénario selon lequel la consommation d’alcool quotidienne ne dépasse pas 1/1.5 verre et la suralcoolisation occasionnelle n’existe pas, et un scénario fondé sur le statu quo en termes de volumes et de modalités de consommation d’alcool, entre 2020 et 2050.
Source : OCDE (2021[9]), Prévenir la consommation nocive d’alcool, https://doi.org/10.1787/6e4b4ffb-en.
Augmentation des dépenses de santé
Le coût de traitement des maladies et blessures causées par une consommation d’alcool quotidienne supérieure à 1/1.5 verre représente 2.4 % environ du total des dépenses de santé en moyenne dans les pays de l’OCDE. Au total, cela correspond à 138 milliards USD (à PPA) par an dans 52 pays, ou aux dépenses de santé actuelles de l’Australie par exemple, ou à plus de deux fois les dépenses de santé consenties par la Belgique. Dans les États membres de l’UE, l’incidence sur les dépenses de santé est estimée à 2.6 %. Pour la plus grande part, ce coût est associé au traitement de la dépendance à l’alcool, suivi par les dépenses consacrées au traitement des cancers, des maladies cardiovasculaires, des maladies du foie et des blessures liés à l’alcool. Cette estimation varie considérablement d’un pays de l’OCDE à l’autre – de 0.1 % en Turquie à 4.2 % en Lituanie – ce qui tient à la fois au niveau de consommation d’alcool, au niveau correspondant de la charge de morbidité dans chaque pays et au coût des services de santé (Figure 2). En valeur absolue, les dépenses les plus importantes devraient être consenties dans les pays où le coût des traitements médicaux est le plus élevé, comme les États-Unis, le Luxembourg et l’Allemagne.

Note : ces résultats sont obtenus en comparant un scénario selon lequel la consommation d’alcool quotidienne ne dépasse pas 1/1.5 verre et la suralcoolisation occasionnelle n’existe pas, et un scénario fondé sur le statu quo en termes de volumes et de modalités de consommation d’alcool, entre 2020 et 2050.
Source : OCDE (2021[9]), Prévenir la consommation nocive d’alcool, https://doi.org/10.1787/6e4b4ffb-en.
Baisse des résultats scolaires
En moyenne, un adolescent sur cinq s’était déjà enivré au moins deux fois dans sa vie en 2017‑18, dans 26 pays de l’OCDE (Inchley et al., 2020[15]). Les adolescents qui déclarent être souvent ivres sont deux fois plus susceptibles que ceux qui n’ont jamais consommé d’alcool d’avoir des comportements antisociaux envers leurs camarades de classe, même s’il est impossible d’établir un lien de causalité. Ils font également état d’une moindre satisfaction à l’égard de la vie et de moins bons résultats à l’école.
La consommation nocive d’alcool à l’adolescence a un effet délétère sur les résultats scolaires. Il ressort de l’analyse de séries de données longitudinales provenant des États-Unis, de la Fédération de Russie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni qu’à long terme, les élèves qui ont des comportements dangereux au regard de leur consommation d’alcool ont de moins bons résultats scolaires et un niveau d’instruction plus faible, en particulier chez les filles (OCDE, 2021[9]). À plus long terme, la baisse des résultats scolaires influe sur la formation du capital humain, la croissance économique, le bien-être social et le creusement des inégalités.
Baisse de l’emploi et de la productivité du travail
Les personnes atteintes de maladies chroniques sont plus susceptibles d’être au chômage ou de manquer des jours de travail. Lorsqu’elles travaillent, elles sont aussi moins productives que les personnes en bonne santé - un phénomène aussi désigné sous le nom de présentéisme. Les conclusions du rapport de l’OCDE intitulé Prévenir la consommation nocive d’alcool donnent à penser qu’à l’échelle de l’OCDE, l’emploi de la population d’âge actif (18‑65 ans) diminuerait de 0.33 % par an entre 2020 et 2050 en raison des maladies et blessures causées par une consommation d’alcool quotidienne supérieure à 1/1.5 verre. Cet effet varie considérablement d’une région à l’autre ; les marchés du travail d’Europe centrale et orientale sont les plus touchés, avec une réduction de l’emploi pouvant atteindre 0.67 % en Lettonie. En outre, en moyenne dans les pays de l’OCDE, 0.11 % de la productivité de la main-d’œuvre est perdue chaque année en raison d’absences pour maladie, et 0.24 % sous l’effet d’une baisse de la productivité au travail sous la forme de présentéisme.
Des conséquences préjudiciables pour l’économie
Si l’on combine tous les effets sur l’espérance de vie, les dépenses de santé, le taux d’activité et la productivité, on estime qu’en moyenne dans les pays de l’OCDE, le PIB pourrait être inférieur de 1.6 % à ce qu’il serait autrement au cours des 30 prochaines années sous l’effet des maladies et blessures causées par une consommation d’alcool quotidienne supérieure à 1/1.5 verre. La Lituanie serait le pays le plus durement touché, avec une diminution attendue de près de 4 % du PIB. L’impact sur le PIB dans 24 pays de l’UE est comparable, à 1.9 %. La baisse du PIB dans les 48 pays pris en compte dans l’analyse s’élève à 1 600 milliards USD (à PPA) au total par an entre 2020 et 2050, soit l’équivalent du PIB annuel moyen du Canada ou de l’Espagne (OCDE, 2021[9]).
Pour faire face aux pressions budgétaires accrues causées par les maladies liées à l’alcool, dans les faits, les populations des pays de l’OCDE paient un impôt de 232 USD (à PPA) par habitant et par an. Ce montant varie selon les pays de l’OCDE, dans une fourchette comprise entre moins de 40 USD (à PPA) en Turquie, aux Pays-Bas, au Mexique et en Italie et plus de 400 USD (à PPA) par habitant en Finlande, en Suède, en Autriche, aux États-Unis et en Irlande.
La prévention des maladies et des blessures liées à l’alcool présente un triple intérêt
Tout d’abord, la consommation d’alcool affaiblit le système immunitaire : pendant la pandémie, la prévention de la consommation nocive d’alcool aide les individus à faire face aux infections (OMS/Europe, 2020[16]). Par ailleurs, certains éléments indiquent que la consommation d’alcool, en particulier si elle est régulière et massive, pourrait nuire à l’acquisition de l’immunité à la suite de la vaccination (Zimmermann et Curtis, 2019[17]).
Ensuite, la prévention de la consommation nocive d’alcool réduit les pressions subies par les services de santé. Les hôpitaux et les professionnels de santé subissent déjà une tension extrême pour parvenir à soigner les patients atteints de COVID‑19. La réduction du recours au système de santé pour les maladies évitables liées à l’alcool aide les médecins à se concentrer à la fois sur les patients atteints du COVID‑19 et sur les patients nécessitant une prise en charge urgente pour d’autres maladies. Par exemple, après avoir interdit la vente d’alcool, l’Afrique du Sud a enregistré une baisse de 65 % de l’utilisation des urgences pour les traumatismes liés à la consommation d’alcool pendant la pandémie (EyeWitness News, 2021[18]).
Enfin, une population en meilleure santé et plus productive sera mieux en mesure de participer à la relance de l’activité économique et de la vie sociale au sortir de la pandémie. Les analyses de l’OCDE montrent qu’une approche globale de type « PPPP » (actions visant à protéger les enfants contre la Promotion de l’alcool ; actions des services de Police pour limiter les blessures et la violence liées à l’alcool ; services de soins Primaires pour aider les patients ayant des comportements dangereux au regard de leur consommation d’alcool ; et politiques de Prix visant à limiter l’accessibilité financière de l’alcool) est à la fois efficace et rentable pour lutter contre la consommation nocive d’alcool. Plus précisément, investir dans un ensemble de mesures comme celui-ci permettra :
de préserver 4.6 millions d’années de vie par an dans les 48 pays couverts par l’analyse, ce qui correspond à peu près au nombre total d’années de vie perdues du fait du cancer du poumon aux États-Unis chaque année, ou au nombre total d’années de vie perdues du fait des maladies cardiovasculaires en Allemagne ;
d’économiser 28 milliards USD (à PPA) environ par an en dépenses de santé dans les 48 pays, soit à peu près 0.5 % du total des dépenses de santé, ce qui équivaut aux dépenses de santé actuelles d’Israël ou à la moitié des dépenses de santé actuelles de la Suède ; et
de générer des économies supérieures aux coûts de mise en œuvre. Pour chaque dollar investi dans un programme d’action global, jusqu’à 16 USD sont restitués sous forme d’avantages économiques.
Il est particulièrement important d’investir dans la protection des enfants et des personnes souffrant de problèmes d’alcool pendant la pandémie
L’ensemble de mesures de type « PPPP » offre une panoplie complète d’outils qui permettraient de lutter efficacement et à moindre coût contre la consommation nocive d’alcool. S'il est intéressant, pour les pays, d’accroître les investissements consacrés à l’ensemble de ces mesures, face à la pandémie de COVID‑19, trois d’entre elles sont plus particulièrement adaptées.
Protéger les jeunes contre la promotion de l’alcool, en particulier par le biais des médias tels que la télévision, Internet et les médias sociaux. Pendant la pandémie, le temps passé devant l’écran (y compris la télévision, les médias sociaux, la vidéo à la demande et la vidéo en ligne) par les enfants a augmenté de 50 % (Axios, 2021[19]). Il est donc possible que l’exposition de ces enfants à la publicité pour l’alcool se soit accrue ; or celle-ci est corrélée à la probabilité de consommer de l’alcool pour la première fois (Jernigan et al., 2018[20]). Pourtant, seule une poignée de pays ont adopté des lois strictes pour protéger les enfants contre la publicité pour l’alcool sur les médias sociaux (OMS, 2020[21]).
Renforcer les soins primaires pour aider les patients qui ont des comportements dangereux au regard de leur consommation d’alcool. On estime que moins de 10 % des patients qui se livrent à une consommation nocive d’alcool sont pris en charge par les services de santé en Europe et aux États-Unis (Sugarman et Greenfield, 2021[22]). Si, comme on peut le penser, le nombre de personnes ayant des habitudes de consommation d’alcool néfastes et des troubles liés à la consommation d’alcool augmente au lendemain de la pandémie, les services de santé doivent être prêts à relever le défi.
S’attaquer à l’alcool bon marché, qui est principalement consommé par les individus ayant des comportements dangereux au regard de leur consommation d’alcool, y compris les jeunes, en adoptant des politiques de prix unitaires minimums. Ces politiques ont un double avantage : premièrement, elles limitent spécifiquement l'accessibilité financière des boissons alcoolisées bon marché. Deuxièmement, elles peuvent avoir des retombées positives sur les bars et restaurants, qui comptent parmi les secteurs les plus durement touchés par la crise économique provoquée par la pandémie, étant donné que les revenus accrus liés aux politiques de prix unitaires minimums restent au sein du secteur.
Les mesures visant à lutter contre la consommation nocive d’alcool impliqueront toujours des arbitrages complexes
La production et le commerce d’alcool représentent une part importante de l’économie dans un certain nombre de pays de l’OCDE. Si les recettes du secteur de l’alcool sont conditionnées par les mesures prises par les pouvoirs publics, à la hausse ou à la baisse, des contre-mesures existent pour réduire au minimum les coûts supplémentaires pour les acteurs du secteur. Des ensembles de mesures complets et bien pensés, assortis d’approches visant à atténuer les conséquences pour le secteur de l’alcool, peuvent contribuer à générer les retombées positives attendues en matière de santé sans avoir d’impact négatif majeur sur l’économie. Par exemple, la réglementation ou les politiques de prix entraînent des coûts d’adaptation, comme ceux associés à l’élaboration d’une nouvelle stratégie ou de nouveaux produits, mais les nouveaux produits peuvent générer de nouvelles recettes. En outre, les données montrent que les économies résultant d’une diminution des dépenses consacrées aux boissons alcoolisées, à la suite de la mise en œuvre des politiques relatives à l’alcool, peuvent être mises à profit pour d’autres biens non indispensables, les restaurants, les hôtels, les loisirs et la culture figurant parmi les secteurs économiques les plus susceptibles d’en bénéficier. De même, les données recueillies en Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis donnent à penser que la baisse de l’emploi dans le secteur de l’alcool peut être partiellement ou totalement compensée par une augmentation de l’emploi dans d’autres secteurs (OCDE, 2021[9]).
Les mesures visant à lutter contre la consommation nocive d’alcool impliqueront toujours des arbitrages complexes, notamment en ce qui concerne leur impact sur l’économie et le marché du travail, ainsi que le type de consommateurs ciblés par ces mesures. Par exemple, les interventions ciblées sur tous les consommateurs offrent un très bon rapport coût-efficacité, mais elles touchent à la fois ceux qui boivent peu ou modérément et les gros buveurs. En revanche, les interventions uniquement ciblées sur les personnes à risque en matière de consommation d’alcool ont un impact significatif à court et moyen terme, mais leur impact est moindre au niveau de la population générale et leurs coûts de mise en œuvre sont généralement plus élevés.
Références
[19] Axios (2021), Kids’ screen time sees a big increase during pandemic - Axios, https://www.axios.com/kids-screen-time-pandemic-112650a6-743c-4c15-b84a-7d86103262bb.html (consulté le 8 avril 2021).
[14] Banque mondiale (2020), DataBank : La Banque mondiale, Données ouvertes de la Banque mondiale, https://databank.banquemondiale.org/home.aspx.
[6] Eurocare (2020), Alcohol Consumption in Times of COVID-19, Eurocare, Bruxelles, https://www.eurocare.org/cares.php?sp=alcohol-and-health&ssp=alcohol-consumption-in-times-of-covid-19 (consulté le 10 novembre 2020).
[18] EyeWitness News (2021), WC Health Dept: Trauma-related cases on NYE dropped by 65% due to alcohol ban, https://ewn.co.za/2021/01/08/wc-health-dept-trauma-related-cases-on-nye-dropped-by-65-due-to-alcohol-ban (consulté le 8 avril 2021).
[26] Gisle, L. et al. (2020), Deuxième enquête de santé COVID-19 : Résultats préliminaires, Sciensano, Bruxelles, https://www.sciensano.be/fr/biblio/deuxieme-enquete-de-sante-covid-19-resultats-preliminaires (consulté le 10 novembre 2020).
[3] HM Revenue and Customs (2020), National Statistics: Alcohol Bulletin Commentary (August to October 2020), HM Revenue and Customs, Londres, https://www.gov.uk/government/publications/alcohol-bulletin/alcohol-bulletin-commentary (consulté le 8 février 2021).
[15] Inchley, J. et al. (dir. pub.) (2020), Spotlight on adolescent health and well-being. Findings from the 2017/2018 Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey in Europe and Canada. International report, Volume 2, Key data, Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Europe, https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/child-and-adolescent-health/health-behaviour-in-school-aged-children-hbsc/publications/2020/spotlight-on-adolescent-health-and-well-being.-findings-from-the-20172018-health-behaviour-in-school-aged-children-hbsc-survey-in-europe-and-canada.-international-report.-volume-2.-key-data (consulté le 20 juillet 2020).
[8] IWSR (2020), Beverage alcohol in 2020 performs better than expected - IWSR, https://www.theiwsr.com/beverage-alcohol-in-2020-performs-better-than-expected/ (consulté le 5 mars 2021).
[20] Jernigan, D. et al. (2018), Alcohol marketing and youth alcohol consumption: a systematic review of longitudinal studies published since 2008, http://dx.doi.org/10.1111/add.13591.
[13] Mahase, E. (2020), « Covid-19: EU states report 60% rise in emergency calls about domestic violence », BMJ (Clinical research ed.), vol. 369, p. m1872, http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m1872.
[5] Ministère fédéral des Finances (2021), Steuereinnahmen 2020.
[4] National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (2020), Alcohol Sales During the COVID-19 Pandemic, Surveillance Report #115, https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/surveillance-covid-19/COVSALES.htm (consulté le 15 mars 2021).
[7] Nielsen (2020), Rebalancing the « COVID-19 Effect » on Alcohol Sales, Nielsen, Chicago, Il, https://nielseniq.com/global/en/insights/2020/rebalancing-the-covid-19-effect-on-alcohol-sales/ (consulté le 10 novembre 2020).
[9] OCDE (2021), Preventing Harmful Alcohol Use, Études de l’OCDE sur les politiques de santé, Éditions OCDE, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/6e4b4ffb-en.
[1] OCDE (2020), Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2020 : Crise du COVID-19 et protection des travailleurs, Éditions OCDE, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/b1547de3-fr.
[10] OCDE/FIT (2020), Road Safety Annual Report 2020, OCDE/FIT, Paris.
[11] OMS (2021), La violence à l’encontre des femmes, https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women (consulté le 7 mai 2021).
[21] OMS (2020), Système mondial d’information sur l’alcool et la santé (GISAH), https://apps.who.int/gho/data/node.gisah.GISAHhome?showonly=GISAH (consulté le 24 juin 2020).
[16] OMS/Europe (2020), Alcohol and COVID-19: what you need to know, Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Europe, https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/437608/Alcohol-and-COVID-19-what-you-need-to-know.pdf (consulté le 8 avril 2021).
[25] Pollard, M., J. Tucker et H. Green (2020), « Changes in adult alcohol use and consequences during the COVID-19 pandemic in the US », JAMA Network Open, vol. 3/9, p. e2022942, http://dx.doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.22942.
[24] Sallie, S. et al. (2020), « Assessing international alcohol consumption patterns during isolation from the COVID-19 pandemic using an online survey: Highlighting negative emotionality mechanisms », BMJ Open, vol. 10/11, http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2020-044276.
[27] Santé publique France (2020), Tabac, Alcool : Quel impact du confinement sur la consommation des Français ?, Santé publique France, Paris, https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/tabac-alcool-quel-impact-du-confinement-sur-la-consommation-des-francais (consulté le 10 novembre 2020).
[12] Silverio-Murillo, A., J. Balmori de la Miyar et L. Hoehn-Velasco (2020), « Families under Confinement: COVID-19, Domestic Violence, and Alcohol Consumption », SSRN Electronic Journal, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3688384.
[22] Sugarman, D. et S. Greenfield (2021), « Alcohol and COVID-19: How Do We Respond to This Growing Public Health Crisis? », Journal of General Internal Medicine, vol. 36/1, pp. 214-215, http://dx.doi.org/10.1007/s11606-020-06321-z.
[23] Tran, T. et al. (2020), « Alcohol use and mental health status during the first months of COVID-19 pandemic in Australia », Journal of Affective Disorders, vol. 277, pp. 810-813, http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2020.09.012.
[2] Winstock, A. et al. (2020), GDS COVID-19 Special Edition: Key Findings Report | Global Drug Survey, https://www.globaldrugsurvey.com/gds-covid-19-special-edition-key-findings-report/ (consulté le 10 novembre 2020).
[17] Zimmermann, P. et N. Curtis (2019), Factors that influence the immune response to vaccination, American Society for Microbiology, http://dx.doi.org/10.1128/CMR.00084-18.
Contact
Stefano SCARPETTA (✉ stefano.scarpetta@oecd.org)
Mark PEARSON (✉ mark.pearson@oecd.org)
Francesca COLOMBO (✉ francesca.colombo@oecd.org)
Michele CECCHINI (✉ michele.cecchini@oecd.org)
Marion DEVAUX (✉ marion.devaux@oecd.org)
Note
L’enquête spéciale de la Global Drug Survey (GDS) sur le COVID‑19 rassemble 55 811 réponses de 11 pays. La majorité des participants sont jeunes, ont l’expérience des drogues illicites et sont salariés ou étudiants. Les données de l’enquête GDS ne sont pas représentatives de l’ensemble de la population.